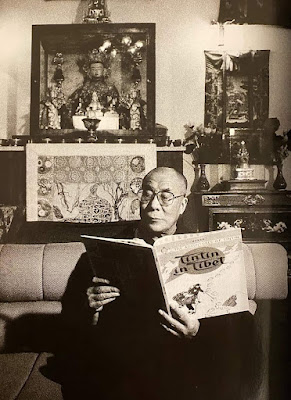...
Pour
la vingt-cinquième des vingt-huit mansions sidérales
comprenant
les deux cent soixante et une sphères célestes :
●
« L'occultisme est aussi une chose fort récente, peut-être même un peu plus récente encore que le spiritisme ; ... [ que Guénon date de la seconde moitié du XIXe siècle ]
« ... ce terme semble avoir été employé pour la première fois par Alphonse-Louis Constant plus connu sous le pseudonyme d'Éliphas Lévi et il nous parait bien probable que c'est lui qui en fut l'inventeur.
« Si le mot est nouveau, c'est que ce qu'il sert à désigner ne l'est pas moins : [ ... ] on n'avait jamais cherché à réunir [ la magie, l'alchimie et l'astrologie ] en un corps de doctrine unique ...
[ où les « sciences occultes » sont parfois qualifiées de magie ]
« ... ce qu'implique essentiellement [ sa ] dénomination [ comme ] occultisme.
« À vrai dire, ce soi-disant corps de doctrine est formé d'éléments bien disparates : Éliphas Lévi voulait le constituer surtout avec la kabbale hébraïque, l'hermétisme et la magie ; ...
« ... ceux qui vinrent après lui devaient donner à l'occultisme un caractère bien différent. » [ ... ]
« Éliphas Lévi mourut en 1875, l'année même où fut fondée la Société Théosophique ; ...
« ... en France, il se passa alors quelques années pendant lesquels il ne fut plus guère question d'occultisme ; ...
« ... c'est vers 1887 que le Dr Gérard Encausse sous le nom de Papus reprit cette dénomination en s'efforçant de grouper autour de lui tous ceux qui avaient des tendances analogues ...
« ... et c'est surtout à partir du moment où il se sépara de la Société Théosophique en 1890 qu'il prétendit en quelque sorte monopoliser le titre d'occultisme [ qui pouvait s'étendre aux théosophistes et aux néo-rosicruciens anglais ] au profit de son école.
« Telle est la genèse de l'occultisme français ; ...
« ... on dit parfois que cet occultisme n'était en somme que du « papusisme » et cela est vrai à plus d'un égard car une bonne partie de ses théories ne sont effectivement que l’œuvre d'une fantaisie individuelle ; ...
« ... il en est même qui s'expliquent tout simplement par le désir d'opposer à la fausse « tradition orientale » des théosophistes une « tradition occidentale » non moins imaginaire ...
[ que Guénon qualifie de « néo-spiritualistes ». ]
« Le premier effet [ de l'éclectisme de ce néo-spiritualisme ] fut la réunion à Paris dès 1889 d'un « Congrès spirite et spiritualiste » où toutes les écoles [ de l'occultisme ] étaient représentée ; ...
« ... naturellement, cela ne fit pas disparaître les dissensions et les rivalités ; ...
« ... mais peu à peu les occultistes en arrivèrent à faire dans leur « syncrétisme » peu cohérent une part de plus en plus large aux théories spirites, ...
« ... assez vainement d'ailleurs car les spirites ne consentirent jamais pour cela à les regarder comme de vrai « croyant ». [ ... ]
En contre-partie, Mme Annie Besant devait déclarer en 1898 devant l'Alliance Spiritualiste de Londres que les deux mouvements « spiritualiste » et « théosophiste » avaient eu la même origine.
Cf. René Guénon – L'erreur spirite – Distinctions et précisions nécessaires – Spiritisme et Occultisme (1923)